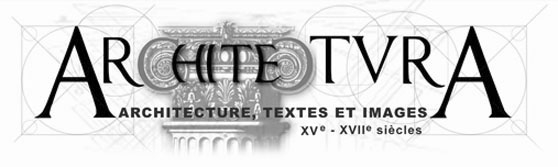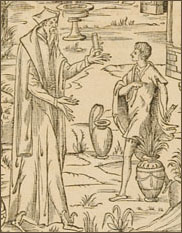Les livres d'architecture
| Auteur(s) | Labacco, Antonio |
|---|---|
| Titre | Libro... appartenente a l'architettura... |
| Adresse | Rome, "impresso a casa nostra" |
| Localisation | Biblioteca Nazionale Centrale di Roma |
| Mots matière | Ordres; antiques |
Né à Vercelli en 1595, Antonio Labacco vint très jeune à Rome où il collabora avec Bramante et surtout Antonio da Sangallo le Jeune sur le chantier de Saint-Pierre. Il réalisa sur les plans de ce dernier la célèbre et imposante maquette en bois de la basilique, conservée au musée de la Fabrique de Saint-Pierre. Après la mort de Sangallo et la nomination de Michel-Ange à la tête du chantier, en 1546, il fut écarté de l’entreprise. Il se consacra alors à la rédaction du Libro, pour lequel il obtint de Paul III en 1549 un privilège pour la publication. Celle-ci n’intervint qu’en 1552, avec plusieurs avatars ; c’est le fils d’Antonio, Mario, qui l’aurait persuadé de faire graver ses dessins sur cuivre et se serait chargé du travail (« Alli lettori »). L’ouvrage connut le succès, publié à de nombreuses reprises à Rome, puis à Venise, pendant tout le XVIe siècle, avec des variantes légères dans l’ordre des images et la présence des textes, jusqu’à une dernière édition en 1773. L’ouvrage a été souvent relié dans un même volume avec la Regola de Vignole (1562), la représentation des édifices antiques de Labacco et l’exposé du système des ordres de Vignole se complétant mutuellement comme le Terzo libro (1540) et le Quarto libro (1537) de Serlio.
Dans la lignée du Terzo libro, Labacco propose une anthologie de monuments antiques (dont certains n’apparaissent pas chez le Bolonais), présentés en plans, élévations perspectives et coupes, à la manière de Peruzzi, duquel Labacco était proche (en particulier l’élévation du temple de Mars Ultor, déjà reprise par Serlio), et aussi des représentations du Codex Coner, imitées aussi par Serlio. On y trouve le mausolée d’Hadrien, le forum de Trajan avec le temple de Mars Ultor et la colonne Trajane, la basilique Æmilia, le temple de Jupiter Stator, les trois temples du forum Holitorium ; la série se poursuit par un projet contemporain, « di nostra inventione », une église à plan centré liée aux projets pour Saint-Jean des Florentins, avant de se conclure par le plan du port de Trajan à Ostie et le temple de Venus Genitrix, sur le forum de César.
Tous ces édifices sont représentés reconstitués, avec plus ou moins de fantaisie. La basilique Æmilia, par exemple, prend la forme d’un temple à fronton avec un seul niveau d’élévation, alors que le bâtiment originel s’élevait sur deux niveaux. Si donc la fantaisie n’est pas absente de ces images, elles présentent des détails très précis qui témoignent de la part de l’auteur d’une excellente connaissance de la théorie. Ainsi, le détail de l’ordre de la basilique (p. 16) montre un ressaut de l’architrave au-dessus du pilastre d’angle, guère remarqué au XVIe siècle : Francesco di Giorgio le représente en 1486 dans un dessin du Codex Sallustiano – mais en reproduisant la disposition sous chaque triglyphe, ce qui n’a aucune raison d’être –, alors qu’Antonio da Sangallo l’Ancien l’omet dans le Codex Barberini. Ce ressaut est parfaitement logique puisqu’il y a une différence de largeur à ce niveau entre la colonne rétrécie et le pilastre qui ne l’est pas : Labacco ne manque pas de commenter le fait dans le texte qui accompagne l’illustration. Autre précision rarement observée au Cinquecento, le fait que le temple dorique du forum Holitorium a des triglyphes sur l’angle. Cette solution est certes vitruvienne mais elle est problématique car elle impose de réduire les entrecolonnements latéraux, et quasiment jamais reprise dans l’architecture du XVIe siècle. Labacco glose cette disposition dans un texte qui fait écho à un commentaire écrit par Antonio da Sangallo sur un dessin du même édifice (Florence, UA 1090r, 1174rv, 1230v).
Bien que jamais traduit, le Libro ne fut pas sans impact sur les architectes français. Deux de ses estampes représentant les chapiteaux corinthien du temple de Jupiter Stator (p. 21) et composite du temple de Venus Genitrix (p. 36) furent directement copiés et transposés sur bois par Philibert Delorme dans son Premier tome, peut-être pour pallier la perte de ses propres dessins, aux folios 194v et 206. Dans les deux cas, Delorme (ou son graveur) s’est contenté du chapiteau, en éliminant les bases. Les deux images réapparaissent en 1599 dans le Premier livre d’architecture de Julien Mauclerc, reportées sur cuivre par Jacques Boyvin avec les bases de Labacco, ce qui laisse à penser que, bien que Mauclerc n’ignorât pas Delorme, la copie fut ici directe.
Un autre édifice illustre témoigne d’une connaissance du livre de Labacco dans sa version de 1552 en France dès le milieu des années 1550 : la tribune des Caryatides dans la grande salle du Louvre. Pierre Lescot et Jean Goujon y ont en effet reproduit plusieurs détails du temple de Mars Ultor : le décor rectangulaire bordé de grecques des soffites (p. 12), et le traitement très orné des bases et de la naissance des colonnes (p. 15).
Yves Pauwels (CESR, Tours) – 2025
Bibliographie critique
A. Bruschi, introduction à la réédition en fac-similé du Libro appartenente a l’architettura ,1559, Milan, Il Polifilo, p. I-XXVI.
F. Colonna, article « Labacco, Antonio », Dizionario Biografico degli Italiani on line – Volume 62 (2004).
P. Gros, « La Basilica Æemilia, de Giuliano da Sangallo à Klaus Stefan Freyberger : problèmes anciens et récents de ses images graphiques et de ses restitutions virtuelles », P. Fleury et S. Madeleine, Topographie et urbanisme de la Rome antique, Caen, Presses universitaires de Caen, 2022.
Y. Pauwels, « Athènes, Rome, Paris : la tribune et l’ordre de la Salle des Caryatides au Louvre », Revue de l’Art, 169, 2010, p. 61-69.
D. Thomson, « Architecture et humanisme au XVI siècle. Le Premier Livre d’Architecture de Julien Mauclerc », Bulletin monumental, 158, 1980, p. 7-40.